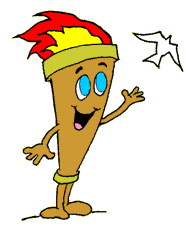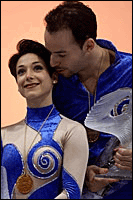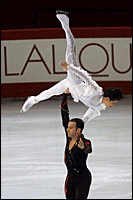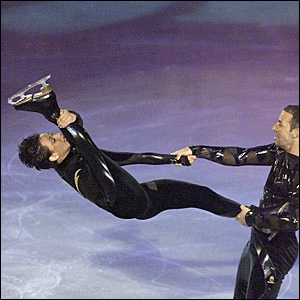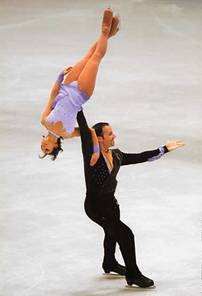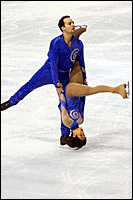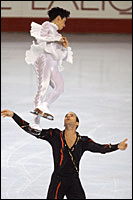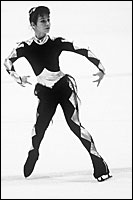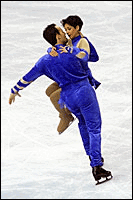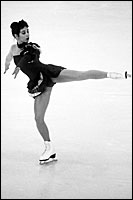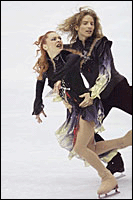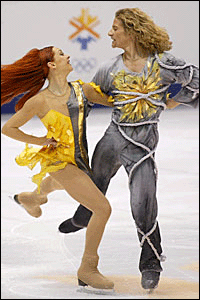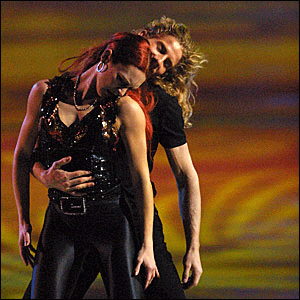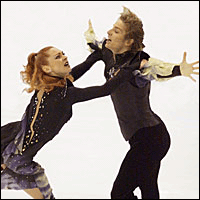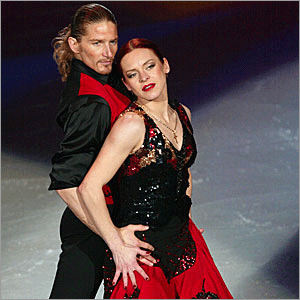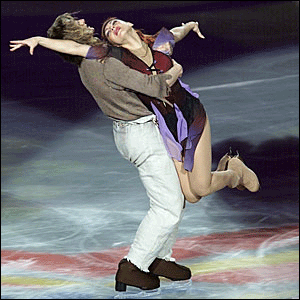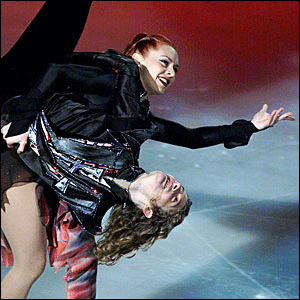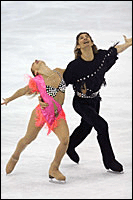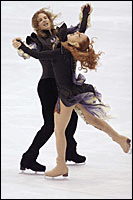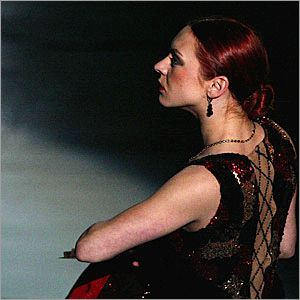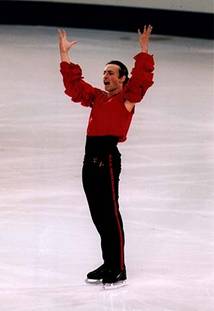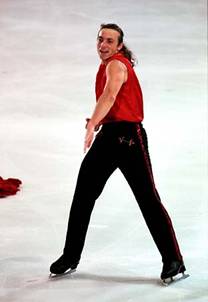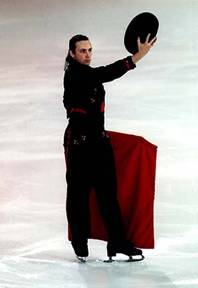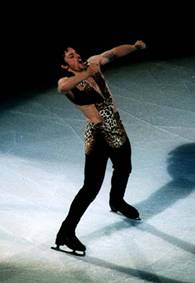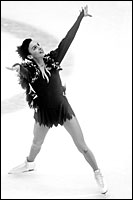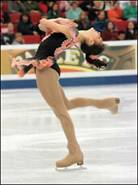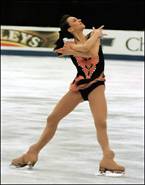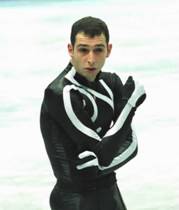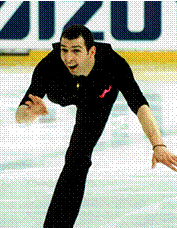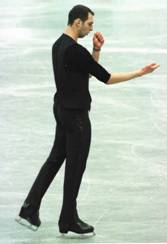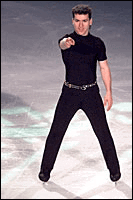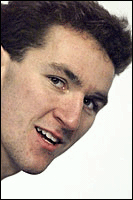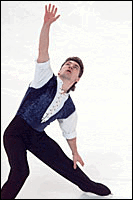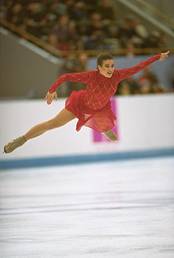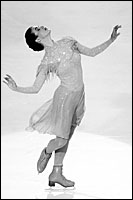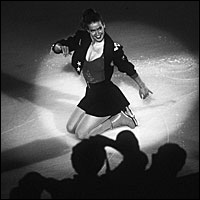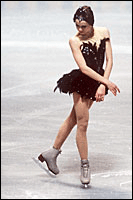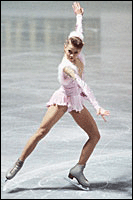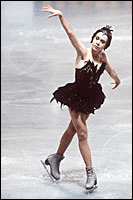|
|
|
|
Les
disciplines :
- Patinage artistique
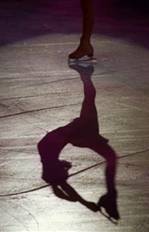 Le patinage artistique, sport où
l'effet gracieux, la recherche de l'élégance, le désir de plaire et de
"faire esthétique" comptent tout autant que la "technique"
et "l'athlétique", peut-il prétendre au label de sport à part entière
? N'est-il pas plutôt un art ? La réalité est à mi-chemin: il conjugue les deux
à la fois ?
Le patinage artistique, sport où
l'effet gracieux, la recherche de l'élégance, le désir de plaire et de
"faire esthétique" comptent tout autant que la "technique"
et "l'athlétique", peut-il prétendre au label de sport à part entière
? N'est-il pas plutôt un art ? La réalité est à mi-chemin: il conjugue les deux
à la fois ?
Les discussions toujours
passionnées sur le sujet et cette remise en question quasi permanente de la
notion de "vrai sport", sont de toute façon sans objet puisque le
Comité Olympique International (CIO) a logiquement choisi d'inscrire d'entrée
cette belle discipline au programme des premiers jeux Olympiques d'Hiver, à
Chamonix, en 1924, après l'avoir antérieurement intégrée aux Jeux d'Eté en 1908
et 1920.
Le CIO, à preuve du
contraire, ne changera rien.
Remettre en question le
label olympique du patinage artistique est si peu d'actualité que sa
médiatisation, sa popularité extrême, n'ont cessé de croître au cours de la
deuxième moitié du vingtième siècle, avec un indice d'audimat percutant aux
Etats-Unis : deuxième sport à la télé !
Autant de facteurs
favorables pour se maintenir à un sommet majestueux. D'autant qu'au cours des
trente dernières années, d'authentiques stars ont rayonné comme Peggy Fleming
(Etats-Unis), le couple Irina Rodnina - Alexandre Zaitsev (Russie), John Curry
(Grande-Bretagne), Toller Cranston (Canada), Robin Cousins (Grande-Bretagne),
Scott Hamilton et Brian Boitano (Etats-Unis), Katarina Witt (Allemagne) et plus
récemment Oksana Baïul (Ukraine), le couple Ekaterina Gordeieva - Serguei
Grinkov (Russie), Michelle Kwan et Tara Lipinski (Etats-Unis), Kurt Browning et
Elvis Stojko (Canada), Ilia Kulik (Russie) ...
L'école française, pour sa
part, est fière aussi de ses champions prestigieux (sans parler des danseurs) :
Andrée et Pierre Brunet, double champions olympiques de couples (1928 - 1932)
et quadruple champions du monde (1926 – 1928 – 1930 - 1932), Jacqueline du
Bief, championne du monde (1952), Alain Giletti et Alain Calmat, champions du
monde respectivement en 1960 et 1965, Patrick Péra, double médaillé olympique,
Patrick Pera, double médaille olympique et, plus récemment, Surya Bonaly et
Philippe Candeloro sur les podiums mondiaux ou olympiques.
Dans le but de conserver son
standing et de mieux doubler le cap de l'An 2000, le patinage artistique a dû
aussi se moderniser sous l'autorité de la Fédération internationale, l'ISU
(International Skating Union, fondée en 1892). Suppression notamment, en 1990,
des anachroniques figures imposées (ou figures d'école), et volonté affichée de
mettre de l'ordre au niveau de la clarification du système de classement,
principalement au plan du jugement et des cotations, grâce à l'apport partiel
de la vidéo et une répartition par tirage au sort plus rigoureuse des juges
composant des jurys désormais renouvelés à chaque passage.
La recherche maximale de
l'impartialité est en effet un souci constant dans ce sport à jugement humain -
son charme, son mystère, le suspense dans le kiss n'cry (1)
à la lecture des notes sur 6 en technique et en artistique - car il a été trop souvent
critiqué à la suite de combines manifestes, du temps de la rivalité est -
ouest, voire quelques scandales retentissants.
Le patinage artistique, qui
peut être masculin ou féminin et se pratiquer aussi en couples, spécialité
éminemment spectaculaire et même périlleuse - la danse sur glace constituant
une famille à part -, n'a en tout cas plus rien à voir aujourd'hui avec ce
qu'il était au temps où il se pratiquait comme un divertissement sur des
patinoires naturelles (lacs ou étangs), ni même au temps où Sonja Henie, la
jolie blonde Norvégienne d'Oslo, qui devint star à Hollywood, cumulait titres
mondiaux (dix de 1927 à 1936) et titres olympiques (trois: 1928-1932-1936) et
faisait fantasmer les messieurs.
Quelques pionniers sont en
effet passés par là pour anoblir et embellir l'exercice d'une discipline par
ailleurs superbement harmonieuse grâce à l'évolution glissée sur la glace, à la
faveur de poussées avant (le pas des patineurs), de poussées arrière, de
croisés qui accentuent la vitesse de déplacement, de courbes ou spirales,
d'arabesques, sans parler des pirouettes sautées, assises, allongées, cambrées,
avec changements de pieds ... (ou la fameuse pirouette pied - tête de la
Suissesse Denise Bielmann).
Si les Américains Jackson
Haynes, les Norvégiens Lutz et Axel Paulsen, le Suédois Ulrich Salchow, etc...
grands précurseurs ou inventeurs de sauts, ont donné, à l'origine, au patinage,
un élan et un nouveau visage, on est passé à des prouesses techniques de plus
en plus remarquables avec les triples sauts et le premier quadruple boucle
piqué (quatre rotations) réussi lors des Championnats du monde en mars 1988, au
Mondial à Budapest, par le Canadien Kurt Browning. L'intrépide Surya Bonaly, en
plusieurs circonstances le tenta également et faillit même le réussir au
Mondial, à Munich, en 1991. La Japonaise Midori Ito fut, elle, la première
femme à passer le triple axel, au Mondial à Paris, en 1989.
Les meilleurs patineurs
masculins, en l'An 2000, multiplient désormais les triples y compris en
combinaisons et tentent le quadruple. On notera, à ce sujet, que sur les six
sauts classiques, les plus difficiles sont dans l'ordre l'axel avec appel vers
l'avant, puis le lutz et le flip (piqués), le boucle, alors que le
salchow et le boucle piqué sont plus faciles.
Parallèlement à la
technique, l'évolution s'est aussi accomplie au plan artistique avec
l'apparition de chorégraphes auprès des entraîneurs, la composition plus
affinée des programmes musicaux et le choix de thèmes favorisant une meilleure
mise en scène sur la glace.
L'esprit aussi a changé. La
distinction entre amateurs (éligibles) et professionnels (non éligibles) est de
plus en plus délicate à établir. Des sommes d'argent considérables sont en
effet mises en jeu, autant dans le circuit dit amateur (Grand Prix ISU) que
dans le circuit dit professionnel, sans parler des tournées, galas et
exhibitions pour tous. L'instauration de pro-am, ouverts aux deux élites,
ajoute-t-elle au risque d'une certaine confusion des genres ? L'ISU, heureusement,
veille à ce que les abus soient évités.
(1) Littéralement :
rire et pleur. Emplacement où les concurrents, aux côtés de leurs entraîneurs,
s'installent après avoir effectué leur programme pour prendre connaissance de
leurs résultats ..
- Danse sur glace

Cette discipline qui cultive
sa singularité, son originalité, voire une certaine indépendance à l'égard du
patinage classique, dit artistique, occupe désormais une place de choix dans
les grandes compétitions internationales et olympiques.
Elle a connu un phénomène
d'engouement exceptionnel à partir du moment où le CIO lui a ouvert grand les
portes des jeux Olympiques, en 1976, à Innsbruck. La danse avait déjà effectué
son entrée officielle aux Championnats du monde 1952, à Paris.
Spécialité uniquement
pratiquée en couples, elle s'est rapidement imposée par son brio à la
télévision qui l'a grandement popularisée. La danse a alors évolué radicalement
vers plus de vitesse, de technique (précision des carres), de virtuosité dans
les mouvements et les combinaisons, tout en repoussant sans cesse les
frontières de la création artistique.
On est sorti progressivement
de la transposition pure et simple, sur la glace, de la danse de salon "à
l'anglaise". Fini le ball - room avec ses rumba, tango romantica, valse
viennoise, fox-trot, paso-doble... au caractère notoirement répétitif et assez
"ringard". Place à de la danse pure, classique ou moderne, magnifiée
par l'expression gestuelle et artistique, une forte interprétation, à la faveur
d'une chorégraphie généralement à thème: comédie, tragédie, exotisme, humour,
folklore...
La danse sur glace a offert
une sorte d'invitation au rêve et même influencé tout le milieu du patinage,
avec l'exceptionnel élan donné par la brillante école russe, très inspirée du
Bolchoï de Moscou et du Kirov de Saint-Pétersbourg et notamment le génie
créatif de Tatiana Tarassova.
Seul inconvénient: les
critères de jugement sont très difficiles à déterminer en danse sur glace. Pas
de sauts individuels ou lancés très périlleux comme dans le patinage de couple
ou individuel. Une rotation et demie seulement en sauts. Trois à cinq rotations
en pirouettes.
Base essentielle de
l'évolution sur la glace d'un couple de danseurs: les partenaires ne doivent
pas se séparer longtemps et suivre le bon tempo et le caractère de la danse en
recherchant la difficulté des pas.
Ainsi, la danse sur glace,
trop souvent montrée du doigt, avec ses classements pré-établis selon la
notoriété des couples, a-t-elle été fréquemment mêlée à de nombreuses controverses,
voire des scandales.
Alerté par le CIO, qui
menaçait d'exclure la danse du programme des J.O., la Fédération internationale
a réagi sagement en décidant, dès 1999, de renouveler les jurys à chacun des
trois passages: danses imposées, danse de création et libre, pour éviter les
combines et améliorer l'objectivité.
Il eût été en effet dommage
que disparaisse des J.O. une discipline qui a tant marqué l'histoire avec
quelques couples célèbres comme les Britanniques Torvill - Dean, les Russes
Bestemianova - Bukhin, Klimova - Ponomarenko et Gritschuk - Platov.
La France n'a pas été
absente de ce panorama avec dans un premier temps Christiane - Jean-Paul Guhel,
puis Isabelle et Paul Duchesnay, enfin plus récemment Sophie Moniotte - Pascal
Lavanchy et Marina Anissina - Gwendal Peizerat.
Quelques
photos de mes champions préférés :
- Equipe de France

Marina Anissina – Gwendal Peizerat – Sarah Abitbol –
Stéphane Bernadis et Vanessa Gusmeroli
- Sarah ABITBOL & Stéphane BERNADIS (France)
ABITBOL Sarah
Site : http://www.abitbolbernadis.com/
Date et
lieu de naissance :
08/06/1975 à Nantes (44)
Taille et poids : 1,50 m ; 43 kg
Lieu de résidence : Paris
Autres sports pratiqués : aérobic, natation
Loisir : danse
Début en patinage : 7 ans
Club : Français Volants
BERNADIS
Stéphane
Date et
lieu de naissance :
23/02/1974 à Boulogne-Billancourt (banlieue Paris)
Taille et poids : 1,80 m ; 80 kg
Lieu de résidence : Bougival
Autres sports pratiqués : golf, tennis
Loisirs : cinéma, voitures de sport
Début en patinage : 8 ans
Club : Français Volants
Abitbol / Bernadis
Entraîneur : Jean-Christophe Simon
Chorégraphe : Tatiana Tarasova
Ancien entraîneur : Jean-Roland Racle, Stanislas Leonovitch (Rus)
Programme court : "La Strada" de Nino Rota
Programme libre : "La Famille Adams" de Mark Shaiman
Jeux Olympiques : 6e (1998) ; forfait (2002), 12ème (2003)
Championnat du Monde : 19e (1993), 10e (1994), 9e (1995), 11e (1996), 7e
(1997), 8e (1998), 5e (1999), 3e (2000), abandon (2001),forfait (2002), 12e
(2003)
Championnat d'Europe : 14e (1993), 15e (1994), 7e (1995), 3e (1996), 4e
(1997), 3e (1998, 1999, 2000) ; 3e (2001), 2e (2002, 2003)
Championnat de France : 2e (1993), 1er (1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002,2003)
Grand Prix ISU :
Saison 1997-98 : 3e Skate Canada
Saison 1998-99 : 1er Trophée Lalique, 6e (Skate Canada), 4e (Finale à
St-Petersbourg / Rus)
Saison 1999-00 : 1er (Trophée Lalique), 2e (Skate America), 2e (Trophée NHK),
2e (Finale à Lyon)
Saison 2000-2001 : 1er (Coupe des nations), 4e (Trophée Lalique), 2e (Trophée
NHK), 5e ( Finale à Tokyo/Jap)
Saison 2001-2002 : 3e (Trophée Lalique), 3e (Coupe de Russie), 6e (Finale à
Kitchener/Can)
Saison 2002-2003: 2e (Trophée Lalique)
10.04.2003
Ils étaient pourtant partis motivés à Washington, après leur médaille d'argent
remportée à Malmö. Mais le sort s'acharne sur le couple qui lors du programme
long aux Championnats du Monde a dû interrompre son programme suite à la
blessure à la cheville de Sarah. Véritable contre-performance pour le couple
qui termine donc à la 12ème place et revient désappointé de ces championnats.
Après examen du médecin, aucune lésion grave n'a été décelée sur la cheville de
Sarah et ils ont donc pris part à la Tournée des Etoiles de la Glace qui a
débuté à Nîmes le 1er avril. Le couple adoré du public français et
international, bénéficie d'un soutien sans faille et a eu le privilège d'une
standing ovation lors du gala de Monaco. Pour l'instant, Sarah et Stéphane
n'ont pas encore déterminé leur choix sur la poursuite de la compétition ou
non.
06.03.2003
En décrochant leur dixième titre consécutif de Champions de France en décembre
dernier, Sarah et Stéphane reviennent au coeur de la compétition. Après leur
forfait aux Jeux Olympiques, le couple français est revenu à la compétition
lors du 16ème Trophée Lalique en décrochant la 2ème place. Depuis, ils ont
effectué un beau parcours, malgré encore une légère appréhension au niveau des
sauts.
La médaille d'argent obtenue à Malmö les a remis en confiance, juste un an
après la blessure de Sarah. Le couple dispute les Championnats du Monde dans
l'optique de monter sur le podium et retrouver ainsi les favoris du niveau
international. Pour cela, ils pourront compter sur leur nouvel entraîneur
Jean-Christophe Simon, qui a pris le relais de Stanislas Leonovitch depuis
février dernier.
01.02.2002
Grâce à eux, un couple français est remonté sur un podium international (Europe
en 1996) …. 64 ans après la dernière médaille obtenue dans la spécialité par le
duo Andrée et Pierre Brunet (or olympique en 1932)! Entraînés par Jean-Roland
Racle puis par le Russe Stanislas Leonovitch depuis 1999, le couple tire parti
de la quintessence de ses moyens et continue à progresser grâce à un travail
opiniâtre récompensé par neuf titres nationaux d'affilée, quatre médailles de
bronze européennes, une de bronze mondiale et, tout récemment à Lausanne, par
une médaille d’argent aux Championnats d’Europe. Sa performance aux Jeux de
Salt Lake City passe par l'exécution réussie du triple axel lancé.
01.02.2000
Longue, très longue a été l’attente avant le retour d’un couple français sur un
podium européen en 1996. En fait, il aura fallu patienter exactement...
64 ans et le dernier podium d’Andrée et Pierre Brunet, en 1932, année de leur
second couronnement olympique !
Cette constatation pourrait paraître désespérante si on ne savait ce que
représente l’extrême complexité pour former un couple en patinage artistique
avec la difficulté des portés acrobatiques, des sauts individuels synchronisés,
des sauts lancés, des pirouettes synchronisées...
Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis ont non seulement, à force d’un travail
admirable et acharné, maîtrisé tous ces éléments avec maestria, mais ils ont
aussi gravi les marches du podium européen, à Sofia en 1996, renouvelant cet
exploit en 1998 à Milan et en 1999 à Prague. Ils ont fait le bonheur de leur
entraîneur Jean-Roland Racle, ancien sélectionné olympique (avec Florence Cahn)
aux Jeux 1972 de Sapporo qui les prit sous sa coupe à la suite d’une épreuve de
détection pour couples organisée en 1992, à Paris-Bercy.
« On a eu tout de suite cette même envie, cette même fougue d’y arriver », a
déclaré Sarah Abitbol, petit bout de femme de 1,50 m et 43 kg, taille idéale
pour patiner en couple avec Stéphane Bernadis, solide patineur.
Ensemble, ils ont accumulé les titres de champions de France, sept jusqu’à l’An
2000, tout en affirmant leur talent à l’échelon international. « Le premier
podium européen de 1996 a été un tournant dans notre carrière, a confié
Stéphane Bernadis. On a réalisé qu’on pouvait faire de grandes choses et nous
hisser au niveau des autres chefs de file de l’Equipe de France comme Philippe
Candeloro et Surya Bonaly qui convoitaient les podiums.
Sixièmes aux Jeux de Nagano, en 1998, ils ont tenté de mettre au point le
triple axel lancé, conseillés depuis 1999 par l’ancien champion russe Stanislas
Leonovitch.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avec Philippe Candeloro
|
|
|
|
Avec Nelson Monfort
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Marina ANISSINA & Gwendal PEIZERAT (France)
ANISSINA
Marina
Date et lieu de naissance : 30/08/1975 à Moscou (Rus)
Taille et poids : 1,61 m ; 47 kg
Lieu de résidence : Lyon
Autres sports pratiqués : tennis, ski nautique
Loisirs : broderie, musique
Début en patinage : 4 ans
Anciens partenaires : Ilia ovation, Sergei Sakhnovski
Club : CSG Lyon
PEIZERAT
Gwendal
Date et lieu de naissance : 21/04/1972 à Bron (69)
Taille et poids : 1,73 m ; 60 kg
Lieu de résidence : Lyon
Autres sports pratiqués : ski, ski nautique, escalade, plongée sous
marine, tir, tennis, golf
Loisirs : piano, lecture, cerf-volant, informatique, photographie
Début en patinage : 3 ans
Ancienne partenaire : Marina Morel
Club : CSG Lyon
Anissina - Peizerat
Entraîneur : Muriel Boucher-Zazoui
Chorégraphe : Bruno Vandelli, Antonio Najarro, Pascal Gaona
Danse originale : Malagua (Flamenco)
Programme libre : Non merci (Claude Petit) et Canone Inverso (Emmio
Moriconne)
Jeux Olympiques : 3e (1998) ; 1er (2002)
Championnat du Monde : 10e (1994), 6e (1995), 4e (1996), 5e (1997),2.
(1998, 1999), 1e (2000), 2e (2001)
Championnat d'Europe : 12e (1994), 5e (1995), 4e (1996, 1997), 3e(1998),
2e (1999), 1er (2000), 2e (2001)
Championnat de France : 2e (1994, 1995), 1er (1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002 : forfait)
Championnat du Monde juniors : 1er (1990), 4e (1991), 1er (1992) avec
Ilia Averbukh (Rus)
Grand Prix ISU :
Saison 1995-96 : 1er (Trophée NHK), 2e (Trophée de France, Skate Canada), 3e
(Finale)
Saison 1996-97 : 1er (Trophée Lalique), 2e (Trophée NHK, Skate Canada), 3e
(Finale)
Saison 1997-98 : 2e (Trophée Lalique, Coupe des Nations), 3e (Finale)
Saison 1998-99 : 1er (Skate America, Trophée Lalique, Trophée NHK), 2e (Finale
à St-Petersbourg/Rus)
Saison 1999-00 : 1er (Trophée Lalique), 1er (Trophée NHK), 1er (Finale à
Lyon)
Saison 2000-2001 : 1er (Skate Canada), 1er (Trophée Lalique), 1er (Trophée
NHK/Jap)
Saison 2001-2002 : 1er (Trophée Lalique), 1er (Trophée NHK/Jap), 2e (Finale à
Kitchener/Can)
01.03.2002
A quoi tient le destin ? Pouvait-on imaginer, du temps qu’ils étaient encore
juniors, Marina Anissina, la Moscovite, et Gwendal Peizerat, le Lyonnais,
rivaux dans les Championnats du monde de leur catégorie en danse sur glace –
elle avec Ilia Averbukh, lui avec Marina Morel – s’élancer un jour ensemble à
l’assaut des titres mondiaux et olympiques ?
Tout s’est en fait dénoué au cours de l’année 1993. Le 7 février, Marina
Anissina, deux fois championne du monde juniors avec Ilia Averbukh (1990 et
1992), débarque à Lyon après avoir obtenu l’assentiment de Gwendal Peizerat.
Elle quitte son partenaire tandis que Gwendal Peizerat est seul également,
Marina Morel ayant décidé d’abandonner la compétition.
Marina incarne la grande ligne classique du patinage russe. Gwendal est
plutôt
un « moderne ». Muriel Boucher-Zazoui va alors réussir des prodiges pour que
ces deux tempéraments si différents – « le feu et la glace » dit-elle –
puissent s’unir et former un couple divin.
Marina et Gwendal ne
pourront disputer les Jeux à Lillehammer, en 1994, car Marina n’a pas encore
obtenu la nationalité française. Cette attente aiguise un peu plus leur appétit
de gloire.
Premier podium européen à Milan en 1998 (bronze) avec le programme de « Roméo
et Juliette », et peu après le podium olympique aux Jeux de Nagano derrière les
Russes ovation Krylova –Oleg Ovsiannikov et les Canadiens Shae-Lynn
Bourne–Viktor Kraatz. Ils sont ensuite vices champions du monde, à Minneapolis,
derrière les Russes et devant les Canadiens. Puis nouvelle médaille d’argent
mondiale, en 1999, avec « Le Masque de Fer ».
Leur objectif est alors de tenter de décrocher l’or pour la saison 1999-2000 avec
un nouveau programme, « Carmina Burana », dont la chorégraphie a été en grande
partie montée
par Christopher Dean. A Vienne (Autriche), au mois de février 2000, ils
décrochent le titre européen… trente-huit ans après leurs compatriotes
Christiane et Jean-Paul Guhel. La consécration les attend ensuite sur le sol
français, devant un public niçois survolté à l’occasion des championnats du
monde, en mars 2000. Le Carmina Burana séduit l’ensemble des édiles
internationaux et leur permet d’atteindre leur premier véritable objectif : le
titre de champion du monde ! Le couple Italien Fusar-Poli / Margaglio, en net
progrès, ne parvient pas à inquiéter les deux Lyonnais, si bien que la route
vers la couronne olympique semble toute tracée.
Mais en janvier 2001, à Bratislava, les champions d’Europe et du monde en titre
chutent à dix secondes de la fin de leur nouveau programme « La dernière nuit
de Beethoven », et ne doivent se contenter que de la deuxième marche du podium
européen, derrière Fusar-Poli / Margaglio. Les cartes sont redistribuées et
alors que le monde du patinage attendait une vengeance à la régulière au
Mondial de Vancouver, en mars 2001, il n’a eu droit qu’à une « flagrante
injustice », selon les spécialistes. Les Italiens, inférieurs techniquement à
Marina Anissina et Gwendal Peizerat, décrochèrent le titre mondial à un juge
près. Le défi olympique était lancé...
En 2002, c’est avec Liberta, symbole de la liberté, thème choisi avec leur
nouveau chorégraphe italien Bruno Vandelli, et sur une gestuelle très
contemporaine que le couple français remporta en février à Salt Lake City le
titre olympique après avoir recouvré toute sa confiance en récupérant, en
janvier à Lausanne, celui européen. La consécration définitive d’un couple
exceptionnel qui aura conduit la danse sur glace à son apogée technique et
artistique.
01.02.2000
A quoi tient le destin ? Pouvait-on imaginer, du temps qu’ils étaient encore
juniors, Marina Anissina, la Moscovite, et Gwendal Peizerat, le Lyonnais,
rivaux dans les Championnats du monde de leur catégorie en danse sur glace –
elle avec Ilia Averbukh, lui avec Marina Morel – s’élancer un jour ensemble à
l’assaut des titres mondiaux et olympiques ?
Tout s’est en fait dénoué au cours de l’année 1993. Le 7 février, Marina
Anissina, deux fois championne du monde juniors avec Ilia Averbukh (1990 et
1992), débarque à Lyon après avoir obtenu l’assentiment de Gwendal Peizerat.
Elle quitte son partenaire tandis que Gwendal Peizerat est seul également,
Marina Morel ayant décidé d’abandonner la compétition.
Marina incarne la grande ligne classique du patinage russe. Gwendal est
plutôt
un « moderne ». Muriel Boucher-Zazoui va alors réussir des prodiges pour que
ces deux tempéraments si différents – « le feu et la glace » dit-elle –
puissent s’unir et former un couple divin.
Marina et Gwendal ne pourront disputer les Jeux à Lillehammer, en 1994, car
Marina n’a pas encore obtenu la nationalité française. Cette attente aiguise un
peu plus leur appétit de gloire.
Premier podium européen à Milan en 1998 (bronze) avec le programme de « Roméo
et Juliette », et peu après le podium olympique aux Jeux de Nagano derrière les
Russes ovation Krylova–Oleg Ovsiannikov et les Canadiens Shae-Lynn
Bourne–Viktor Kraatz. Ils sont ensuite vices champions du monde, à Minneapolis,
derrière les Russes et devant les Canadiens. Puis nouvelle médaille d’argent
mondiale, en 1999, avec « Le Masque de Fer ».
Leur objectif est alors de tenter de décrocher l’or pour la saison 1999-2000 avec
un nouveau programme, « Carmina Burana », dont la chorégraphie a été en grande
partie montée
par Christopher Dean. A Vienne (Autriche), au mois de février 2000, ils
décrochent le titre européen… trente-huit ans après leurs compatriotes
Christiane et Jean-Paul Guhel. La consécration les attend ensuite sur le sol
français, devant un public niçois survolté à l’occasion des championnats du
monde, en mars 2000. Le Carmina Burana séduit l’ensemble des édiles
internationaux et leur permet d’atteindre leur premier véritable objectif : le
titre de champion du monde ! Le couple Italien Fusar-Poli / Margaglio, en net
progrès, ne parvient pas à inquiéter les deux Lyonnais, si bien que la route
vers la couronne olympique semble toute tracée.
Mais en janvier 2001, à Bratislava, les champions d’Europe et du monde en titre
chutent à dix secondes de la fin de leur nouveau programme « La dernière nuit
de Beethoven », et ne doivent se contenter que de la deuxième marche du podium
européen, derrière Fusar-Poli / Margaglio. Les cartes sont redistribuées et
alors que le monde du patinage attendait une vengeance à la régulière au
Mondial de Vancouver, en mars 2001, il n’a eu droit qu’à une « flagrante
injustice », selon les spécialistes. Les Italiens, inférieurs techniquement à
Marina Anissina et Gwendal Peizerat, décrochèrent le titre mondial à un juge
près. Le défi olympique était lancé...
En 2002, c’est avec Liberta, symbole de la liberté, thème choisi avec leur
nouveau chorégraphe italien Bruno Vandelli, et sur une gestuelle très
contemporaine que le couple français remporta en février à Salt Lake City le
titre olympique après avoir recouvré toute sa confiance en récupérant, en
janvier à Lausanne, celui européen. La consécration définitive d’un couple
exceptionnel qui aura conduit la danse sur glace à son apogée technique et
artistique.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Philippe Candeloro (France)
Né le 17 février 1972, à Courbevoie.
Club: CSG Colombes.
Entraîneur: André Brunet.
Jeux Olympiques: 3e (1994-1998).
Championnats du monde: 9e (1992-1996), 5e (1993), 2e (1994), 3e (1995).
Championnats d'Europe: 8e (1990), 5e (1991-1994-1996-1998), 4e (1995)
,2e (1993-1997).
Championnats de France: 1er (1994-1995-1996-1997).
D'origine italienne et fils
de Luigi Candeloro,un maçon des Abruzzes et de Marie-Thérese, chef
comptable,Philippe Candeloro, malgré son penchant pour les sports mécaniques,a
eu très vite la passion de la glace qu'il découvrit à Colombes, dès l'âge de 7
ans, dans le cadre du sport scolaire.
André Brunet, eut vite fait
de repérer le côté intrépide et casse-cou d'un enfant qui n'avait pas froid aux
yeux, et il le prit sous son aile protectrice, persuadé qu'il en ferait un
champion. Surnommé "Papy" par Candeloro, André Brunet l'a entraîné
jusqu'à la dernière apparition de Philippe, en compétition amateurs, aux jeux
Olympiques, à Nagano, en 1998: deuxième médaille de bronze (1994-1998). Comme
Patrick Péra (1968-1972).
Aimant se mettre en scène et
profitant de l'exemple des Duchesnay, selon le bon principe qu'au patinage il
faut d'abord plaire au public avant de convaincre les juges, Philippe Candeloro
a marqué son époque par son sens du spectacle, son talent artistique pour
interpréter brillamment les thèmes choisis pour ses programmes, tout en
exposant un formidable potentiel athlétique:hauteur et ampleur du triple axel,
magnifiques combinaisons de triples, vitesse de patinage. Il s'est aussi
affirmé, par son panache, son tempérament combatif exceptionnel, répondant
souvent présent, le jour J, dans les plus grands événements et en particulier
les jeux Olympiques.
En dehors de son entraîneur,
André Brunet, il a bénéficié d'un entourage de qualité avec son préparateur
physique Jacques Dechoux et la chorégraphe d'origine russe, Natacha Dabbadie,
dont l'influence fut déterminante lors de l'ascension de "Candel"
vers les sommets en 1994, aux Jeux de Lillehammer, grâce notamment à une
création géniale qui rencontra un formidable succès populaire avec "le
Parrain", inspiré du célèbre film de Francis Ford Coppola.
La première forte motivation
pour Philippe Candeloro est sans doute venue de son éviction de la sélection
française pour les Jeux d'Albertville, en 1992. Il se faisait une joie en effet
de représenter la France et il cria à l'injustice quand, en décembre 1991, dans
sa propre patinoire, à Colombes, et au terme de championnats de France
sélectifs et très serrés pour Albertville, il se classa seulement 3e, laissant
ainsi la place à Eric Millot, son principal rival français, et Nicolas Pétorin.
Il estima être victime d'une machination, payant très cher son insouciance,
suite à un accident de moto qui avait fait causer car il l'avait stoppé net
dans sa préparation olympique un mois juste avant les championnats.
Privé de JO, il allait
prendre une éclatante revanche, quelques semaines seulement après, lors des
Championnats du monde à Oakland, près de San Francisco. Naissance d'une
authentique étoile de la glace et du label "Candelle rebelle".
Naissance aussi d'une réputation de "show man" qui a traversé les
océans grâce à la télévision. Un fan club Candeloro ne va pas tarder à naître
en France, au Japon, aux Etats-Unis. A Oakland, Candeloro, 20 ans, séduit avec
son programme de "Conan le Barbare". Les 15000 spectateurs américains
lui font une standing ovation, épatés par son audace, ses triples,la
"pirouette assise sur la glace" qu'il a inventée un jour par
hasard(chute!) à Font-Romeu, et une série de sauts accroupis en avant.
Dès lors, le talent de
Philippe Candeloro va rayonner, mais une certaine indolence et des ennuis de
santé ne lui permettront jamais d'atteindre la première place, frôlée plusieurs
fois en une période où les Russes Viktor Petrenko, la Urmanov et Ilia Kulik,
les Canadiens Kurt Browning, Elvis Stojko et l'Américain Tod Eldredge, ont été
ses grands rivaux. Ni titre mondial, ni titre européen: ombre sur un palmarès
brillant.
Avec son magnifique
tempérament, sa forte personnalité, sa gouaille de petit gars de banlieue qui
ne renia jamais ses origines, et son pouvoir de séduction, Philippe Candeloro a
pourtant fait " tilt " auprès des téléspectateurs du monde entier et
séduit par son côté accrocheur et créatif. Il a marqué son époque.
Le sommet de sa carrière est
sans doute Lillehammer, en 1994, dans un final olympique qui rassemblait aussi
quelques stars revenues exceptionnellement dans les rangs amateurs avec la
bénédiction du CIO: Brian des, Kurt Browning et Viktor Petrenko. Son
interprétation du "Parrain" gominé, vêtu de noir avec sa chaîne en or
sur la poitrine est d'une grande intensité émotionnelle (sans parler des sauts).
Candeloro séduit les juges et le public qui craque. Médaille de bronze. Il sera
vice champion du monde peu après, à Chiba, au Japon derrière son ami Elvis
Stojko... mais devant le champion olympique la Urmanov (4e). Des centaines de
fleurs couvrent la glace après son libre.
Candeloro annonce alors
qu'il lui reste quatre ans pour devenir le numéro 1. Il n'atteindra jamais son
but malgré l'innovation constante dans ses programmes
"cinématographiques" où il alternera le drame (Parrain II) avec le
comique (Lucky Luke), l'historique(Bonaparte) et pour finir, le cape et d'épée
(d'Artagnan).
Philippe Candeloro, alias
"Candelorock", ainsi que le surnomme "Paris-Match", suscite
pourtant un enthousiasme indescriptible dans les patinoires du monde entier et
surtout au Japon et aux Etats-Unis avec son exhibition de "Rocky" où
il porte un costume confectionné avec le drapeau américain.
Il affirme qu'il ne
deviendra jamais une star du show-business et qu'il restera toujours un
"enfant du peuple." Mais c'est bien dans son rôle de star et devant
les caméras de télévision, pour l'émission "Super Mecs" de Patrick
Sébastien, qu'il accepte de se déguiser en mousquetaire et ferraille avec
maestria sur le plateau, une épée à la main. La scène est tellement belle que
Candeloro a immédiatement l'idée de choisir "d'Artagnan" comme thème
pour les Jeux de Nagano.
Alors que sa réputation de
"Poulidor du patinage" s'est répandue en France et que certains
raillent ses artifices vestimentaires pour masquer certaines faiblesses techniques,
Philippe Candeloro va gagner son dernier pari aux Jeux de Nagano: médaille de
bronze derrière le Russe Ilia Kulik et le Canadien Elvis Stojko. Il a 26 ans et
annonce alors son mariage prochain avec Olivia et sa volonté de faire des
compétitions open et de créer sa propre tournée. Le "Candel Euro
Tour" est en vue. La "champion" continue.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
des
|
|
|
Saisons de programmes :
91-92 : Shostakovich / Conan le Barbare
92-93 : Cosaque / Conan 2 le
destructeur
93-94 : God father / God father
94-95 : God father / God father
95-96 : Dune / Lucky Luck
96 -97 : Mission
impossible / Napoléon
97-98 : Guérilleros /
D'Artagnan
- Marie-Pierre Leray (France)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Née le
17/02/1975 à Paris |
|
Taille :
1.68m / 52 kg |
|
Profession
: étudiante en droit immobilier |
|
Aime : l'escalade, le
rafting, Paris |
|
Club :
Montpellier |
|
A débuté
le patinage à 9 ans |
|
Reconnue
pour sa grâce et son charme |
|
Meilleurs
résultats : |
- Vanessa Gusmeroli (France)
Date et
lieu de naissance :
19/09/1978 à Annecy (74)
Taille et poids : 1,60 m ; 50 kg
Lieu de résidence : Paris
Autres sports pratiqués : ski nautique, ski alpin, surf des neiges,
golf, équitation
Loisirs : cinéma, musique
Début en patinage : 7 ans
Club : Français Volants
Entraîneur : Katia Beyer
Chorégraphe : Sandra Garde
Ancien entraîneur : Didier Lucine
Programme court : "Cotton Club" de John Barry, "Sing Sing
Sing" de L. Prima
Programme libre : "The Butterfly" et "Microcosmos"
de Vangelis, "Le Serpent" de Guem
Jeux Olympiques : 6e (1998) ; 16e (2002)
Championnat du Monde : 14e (1996), 3e (1997), 16e (1998), 5e (1999), 4e
(2000), 9e (2001)
Championnat d'Europe : 8e (1996), 6e (1997), 11e (1998), 5e (1999), 4e
(2000), 9e (2001), 11e (2002)
Championnat de France : 7e (1994), 5e (1995), 2e (1997), 3e (1998), 2e
(1999), 1er (2000, 2001, 2002), forfait (2003)
Grand Prix ISU :
Saison 1997-98: 3e (Skate Canada, Trophée Lalique)
Saison 1998-99: 3e (Trophée Lalique), 5e (Trophée NHK)
Saison 2000-01: 6e (Coupe des Nations), 4e (Trophée Lalique)
Saison 2001-2002 : 10e (Trophée Lalique)

01.02.2002
Sportive éclectique (excellente en ski nautique), Vanessa ne possède pas encore
le palmarès que sa médaille de bronze mondiale, obtenue à 18 ans, laissait
entrevoir. Elle n’est pas toujours parvenue à tirer parti totalement de ses
grandes qualités physiques et de son élégante présence sur la glace. Formée à
Annecy par Didier Lucine, elle a décidé début 2000 de quitter son environnement
savoyard pour Paris où, entraînée par le Russe Stanislas Leonovitch puis par
Katia Beyer, le déclic escompté n'a pas encore eu lieu malgré deux accessits
prometteurs (4è à l'Europe et au Monde en 2000).
01.02.2000
L’un des talents les plus éclectiques du sport français, Vanessa Gusmeroli a
vécu son enfance et son adolescence entre le lac d’Annecy et la station de ski
de la Clusaz où elle a d’ailleurs effectué ses premières glissades à
patins.
Elle peut se flatter d’être aussi douée en ski nautique (championne de France
Espoirs, vice championne d’Europe en 1991) qu’en patinage artistique. Mais
c’est cette seconde discipline qui l’a rendue célèbre, surtout à partir de
1997, quand elle a réussi l’exploit de monter sur le podium des Championnats du
monde, à Lausanne, troisième derrière les deux Américaines Tara Lipinski et
Michelle Kwan.
Surprise de taille car même si elle avait affirmé déjà ses possibilités aux
Championnats du monde juniors (4e en 1994, 5e en 1995 et 6e en 1996), on ne
s’attendait pas à la voir brûler pareillement les étapes et réussir une telle
performance avec cette médaille de bronze mondiale.
Douée, possédant de réelles qualités athlétiques, Vanessa, longtemps fragile
mentalement et irrégulière sur ses triples sauts, n’a pas su profiter
immédiatement de l’élan de Lausanne, même si sa sixième place aux Jeux de
Nagano fut un bon résultat. Elle s’est maintenue à ce niveau en 1999 (5e
d’Europe à Prague et du monde à Helsinki).
Bien que souffrante (ennuis gastriques), elle remportait en décembre 1999, à
Courchevel, son premier titre de championne de France. Dans le même temps, elle
quittait Annecy, son entraîneur Didier Lucine et ses habitudes de toujours pour
s’installer à Paris afin de suivre un programme de préparation de deux ans en
vue des jeux Olympiques de 2002 à Salt Lake City. Entraînée par Stanislas
Leonovitch, l’ancien champion russe déjà concerné par le couple Sarah Abitbol –
Stéphane Bernadis, très bien adaptée à la vie de la capitale, c’est une Vanessa
Gusmeroli sereine et confiante que l’équipe de France retrouvait en février
2000, aux Championnats d’Europe à Vienne (4ème). Et au mondial de Nice au mois
de mars (4ème). Elle a remporté son deuxième titre de championne de
France, à Briançon, sous la houlette de Katia Beyer.
- Laurent Tobel (France)
Date
de naissance :
24/06/1975
Lieu de naissance : Savigny-sur-Orge
Taille et poids : 1,88 m; 84 kg
Lieu de résidence : Fosse (région parisienne)
Club : CSG Champigny
Entraîneurs Annick Gailhaguet et Pierre Trente
Championnat du monde : 13 (1997) , 16 (1998), 8 (1999)
Championnat d'Europe : 5 (1999)
Championnat de France : 10 (1993), 8 (1995), 5 (1996), 3 (1997),
2(1998), 1 (1999), 5. (2000, 2001)
Championnat de France juniors : 12 (1987)
Grand Prix ISU Saison 1998-99 : 6. (Skate America), 5. (Trophée Lalique)
Saison 1999-00 : 6.(Skate Canada), 4.(Trophée Lalique)
Saison 2000-01 : 12. (Trophée NHK/Jap)
|
|
|
|
|
Unique et atypique! Laurent
Tobel a bousculé bien des préjugés en s'affirmant dans les années
1996-97-98-99, comme l'un des patineurs les plus originaux et les plus
sympathiques du circuit mondial. Signes particuliers:
1,90 m de taille, une incroyable aisance dans des triples sauts effectués avec
une ampleur étonnante et un look inimitable, des mimiques qui font sourire
d'autant que son but est de s'exprimer justement sur le thème de l'humour et de
la drôlerie.
Ce style, qui lui est propre et qui ne séduit pas toujours les juges, a en tout
cas vite conquis le grand public notamment avec son programme de "la
Panthère Rose" qui a tapé dans l'oeil d'un certain Tom Collins, promoteur
de la célèbre tournée des champions aux Etats-Unis et Canada qui dure près de
quatre mois.
Laurent Tobel est peut-être devenu un grand fantaisiste sur la glace -
phénomène plutôt rare dans la compétition internationale - mais il était
aussi au départ, un surdoué au même titre que Philippe Candeloro. Ne fut-il pas
sélectionné pour les Championnats du monde juniors ? C'est en 1989, à la suite
d'une croissance brutale de 20 cm (!) qu'il a dû composer avec une réalité
assez contraignante pour un espoir nourrissant l’objectif de devenir patineur
de haute compétition.
Trop grand? "Non! Répond-il bien qu'ayant cependant envisagé de
tourner le dos au patinage. " J'ai choisi d'assumer cette différence et
d'en faire un atout", précise-t-il.
Controversé, décalé, jovial (sa parodie désopilante du "Lac des
Cygnes"), Tobel, conseillé par Annick Gailhaguet et Pierre Trente, a acquis
une autre dimension en devenant Champion de France, en décembre 1998 à Lyon,
puis 5e d'Europe et 8e du monde.
Il pensait alors mettre le cap sur les Jeux de 2002 à Salt Lake City. Las,
après un début de saison contrarié par une douleur à un genou, il estimait son
avenir olympique compromis et décidait de rejoindre les rangs professionnels à
la fin de l’année 1999…
- Elvis Stojko
(Canada)
|
|
|
|
|
Né: |
22 mars
1972 |
|
Lieu de
naissance: |
|
|
Signes
astrologiques: |
Bélier/Rat |
Stojko a remporté les titres mondiaux en 1994, 1995 et 1997.
Il a aussi décroché des médailles d'argent aux Jeux olympiques en 1994 et 1998.
Il s'est joint à l'équipe nationale senior en 1990.
Trois fois champion du monde, Elvis Stojko a remporté deux
médailles d'argent à Lillehammer en 1994 et à Nagano en 1998.
Au total, il a gagné 22 médailles d'or, dont sept aux
championnats canadiens.
Au fil de sa carrière, il est devenu le premier homme à réussir
une combinaison de quadruple sauts en compétition. Il a également ajouté une
nouvelle dimension au patinage artistique en utilisant le thème des arts
martiaux.
- Katarina Witt
(Allemagne)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aux Jeux de 1984 à Sarajevo, Katarina Witt
remporta la médaille d'or dans l'épreuve dames de patinage artistique, devant
deux championnes du monde, Rosalynn Sumners et Elaine Zayak. En fait, elle est
la seule femme à avoir remporté une compétition olympique individuelle après
s'être classée au-delà de la seconde place au championnat du monde de l'année
précédente (elle était quatrième). Sa victoire fut serrée. Au programme de
patinage libre, cinq juges lui donnèrent la première place contre quatre pour
Sumners. Quatre ans plus tard à Calgary, la compétition fut encore plus
opiniâtre. Katarina Witt s'inclina dans l'épreuve du patinage libre face à
Elizabeth Manley, mais remporta la médaille d'or grâce à ses performances aux
figures imposées et dans le programme court. Elle était la première patineuse à
réitérer cet exploit après Sonja Henie. Elle prit à nouveau part aux Jeux
Olympiques en 1994. Bien qu'elle ne terminât que septième, elle enchanta le
public par un hommage émouvant à Sarajevo, ville dans laquelle elle avait
remporté sa première médaille d'or et qui était alors enlisée dans la guerre
civile.
- Oksana Baiul
(Ukraine)
|
|
|
|
|
Sites Internet :
fédération française des
sports de glace
fédération internationale de
patinage